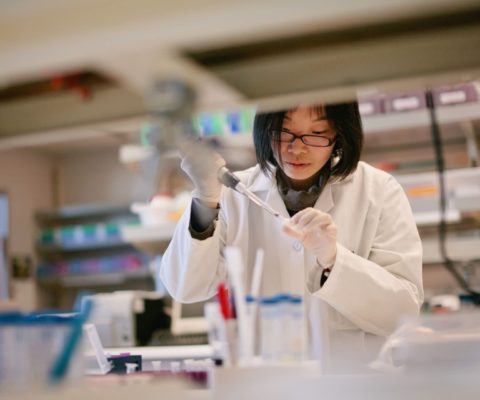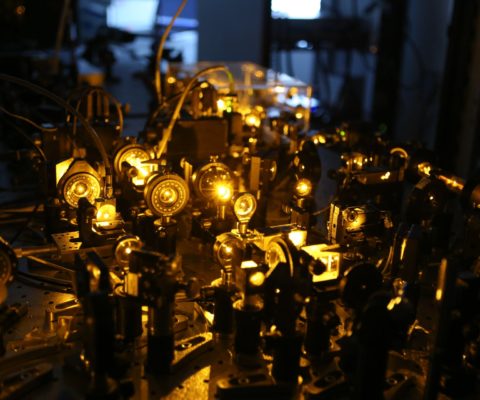Que fait l’Europe ?
Ce que la crise du coronavirus nous dit de l’état de l’Union européenne
Pr Samantha Besson
« Que fait l’Europe ? » Combien de fois n’avons-nous pas entendu cette question depuis le début de la crise sanitaire mondiale entraînée par le COVID-19.
Cette question, nous nous la sommes en fait déjà posée à maintes reprises ces dernières années, et notamment après la crise de l’euro de 2010 et la crise migratoire de 2012. Lors de chacune de ces crises, les Européens se sont étonnés que l’Union européenne (UE) n’adopte pas de mesures communes plus affirmées : des mesures communes de protection des services publics, des structures de sécurité sociale et des travailleurs lors de la première, et des mesures communes d’accueil et d’intégration des étrangers lors de la deuxième.[i]
Il est rassurant, bien sûr, que certains Européens en appellent à davantage d’Europe, mais il est inquiétant qu’ils en sachent si peu sur ce qu’ils peuvent attendre de l’UE. Comme toute organisation internationale, et même si on peut le contester, l’UE n’a que les obligations juridiques de faire ce qu’elle est en droit de faire et, plus précisément, pour lesquelles une compétence lui a été attribuée. Souvent, la réponse à l’absence d’action commune de la part de l’UE tient à son manque de compétences dans les domaines concernés ou, du moins, à son manque de compétences exclusives dans ces domaines. Et si l’UE ne dispose pas de compétences ou uniquement de compétences limitées en ces matières, c’est que les citoyens européens, par le biais de leurs États membres qui sont les « maîtres » des traités de l’UE, n’ont pas convenu de les lui attribuer. Cette absence de généralité ou de plénitude des compétences est ce qui distingue l’UE d’un État « souverain » – ce qui devrait d’ailleurs inciter ceux qui parlent de souveraineté de l’UE à la prudence.
En fait, si l’on se donne la peine d’examiner de plus près les domaines dans lesquels beaucoup d’Européens attendent davantage de l’UE que ce qu’ils ont bien voulu lui permettre de faire, on remarque très vite qu’ils concernent tous, de près ou de loin, des questions sociales : santé, travail, ou encore sécurité sociale et territoriale. Il s’agit précisément de domaines dans lesquels les compétences de l’UE sont limitées. En effet, ces compétences ne s’exercent qu’en alternance avec les États membres (compétences concurrentes), ou alors ne visent qu’à compléter l’action de ces États (compétences parallèles). C’est d’ailleurs clairement le cas dans le domaine de la santé humaine : l’UE n’a que des compétences parallèles ou d’appui des actions des États membres dans ce domaine (art. 6(a) et 168(1-3) Traité sur le fonctionnement de l’UE [TFUE]), si l’on réserve sa compétence concurrente sur certains enjeux communs de sécurité en matière de santé publique identifiés par les traités (art. 4(2)(k) et art. 168(4) TFUE).
Le contraste entre ces compétences limitées de l’UE en matière sociale et ses compétences exclusives (ou, plus rarement, concurrentes) en matière commerciale est très clair. Cette division des compétences entre questions économiques et sociales n’est pas due au hasard. Et surtout, elle n’est pas le propre de l’UE. Au contraire, elle était déjà au cœur du programme néolibéral de Friedrich Hayek, devenu à peu de choses près le modèle de la gouvernance économique internationale d’après-guerre. On parle parfois à cet égard de « fédéralisme de préservation du marché ». Selon ce modèle de gouvernance à niveaux multiples, la gouvernance des questions économiques est entièrement centralisée sur le plan international – qu’il soit régional (comme dans le cas de l’UE) ou universel (à l’instar de l’Organisation mondiale du commerce) –, tandis que les questions sociales relèvent des compétences résiduelles des États membres, et donc de la politique nationale.
Cette séparation de l’économique du social dès le lendemain du second conflit mondial a eu des conséquences importantes pour la protection des droits de l’homme et de la démocratie. Elle se ressent, tout d’abord, très clairement en droit international et européen des droits de l’homme, rendant l’idée même de droits « économiques et sociaux » largement incompréhensible pour la plupart d’entre nous : les droits sociaux y sont en effet réduits à des droits « d’être » (p.ex. ne pas être pauvre, ne pas être malade, être logé), tandis que les droits « de faire » (p.ex. travailler, entreprendre, commercer, jouir de sa propriété) sont protégés uniquement en tant que droits économiques et indépendamment de toute référence à la justice de la pratique sociale dont ils sont pourtant constitutifs. La place secondaire accordée aux droits sociaux (Titre IV) par rapport aux droits et libertés économiques (Titre II) dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE de 2000 n’en est que l’ultime confirmation (cf. art. 52(5), notamment, sur ces « principes » sociaux). Par la suite, la séparation correspondante des niveaux de gouvernance compétents pour traiter des questions soit économiques soit sociales a eu des effets délétères sur la démocratie nationale. Ces effets sont désormais très bien documentés. A tel point d’ailleurs que le « trilemme de la globalisation » de Dani Rodrik selon lequel marché global, souveraineté étatique et démocratie seraient incompatibles en est devenu banal.
Certes, à la différence d’autres organisations internationales économiques, l’UE, ou plus exactement son ancêtre les Communautés européennes, ont fait l’objet d’une série de révisions institutionnelles dès les années 1990 visant à faire d’elle(s) une union « politique ». Conçue en des termes « constitutionnels » par sa Cour de justice depuis les années 1970[ii], l’organisation politique de l’UE ressemble désormais à s’y méprendre à celle des plus démocratiques de ses États membres de tradition fédérale. L’UE dispose d’un Parlement élu au suffrage universel et dont la représentativité est proportionnelle, d’un exécutif bicéphal à défaut d’être bicaméral (intergouvernemental pour le Conseil de l’UE et supranational pour la Commission) et d’une Cour de justice aux pouvoirs de contrôle constitutionnel très étendus[iii].
Ce qui distingue toutefois encore le régime (en apparence) démocratique de l’UE de celui d’un État démocratique tient à l’absence de séparation des pouvoirs (son exécutif supranational, la Commission, est en effet seule détentrice de l’initiative législative qu’elle exerce ensuite avec le Parlement et le Conseil), mais aussi, et surtout, à l’absence de compétences sociales de l’UE, et donc de gouvernement social. En effet, sans compétences dans le domaine social et donc sans moyens d’œuvrer à l’égalité sociale, l’égalité politique que les traités garantissent aux citoyens de l’UE (art. 9 Traité sur l’Union européenne [TUE]) ne peut que demeurer lettre morte. Sans ces compétences, il est tout aussi illusoire d’espérer que la participation politique de ces citoyens et notamment le contrôle effectif qu’ils exercent sur leurs représentants au sein des institutions législatives et exécutives européennes (par l’élection du Parlement européen) puissent se renforcer. Au contraire, le fait que le débat politique européen porte principalement sur la gestion du marché européen à l’exclusion des questions sociales en détourne les citoyens. Par effet de miroir, ensuite, cela transforme bon nombre de débats socio-politiques nationaux en exutoires impuissants, faisant ainsi le lit des populistes et nourrissant diverses formes de repli national, voire de velléités de sortie désormais à l’œuvre dans tous les États de l’UE.
Les gouvernements nationaux ont d’ailleurs très bien compris ce double affaissement de la démocratie européenne et nationale. En adoptant le Traité sur le mécanisme européen de stabilité en 2012 en réponse à la crise de l’euro, ils ont déplacé le centre de décision européen hors des institutions européennes vers le Conseil européen, et ce sans avoir eu à subir de véritable sanction démocratique de la part de leur électorat. Ce faisant, ils ont lancé un processus de détricotage, voire d’abandon du cadre institutionnel de l’UE pour regagner celui, plus souple, mais aussi bien moins démocratique, du droit international. Une expérience qu’ils ont renouvelée lors de la gestion de la crise migratoire avec la Turquie en 2016, et avec laquelle ils renoueront certainement très prochainement, si nous n’y veillons pas, en réponse à la crise du coronavirus.
Le déficit démocratique de l’UE, tant décrié et à l’origine des nombreux appels de la société civile à refonder l’Europe[iv], serait donc inscrit au plus profond de la répartition des compétences de l’UE. Dans ces conditions, il est bien sûr salutaire de poursuivre le travail de démocratisation de l’UE pour assurer davantage de contestation et donc de délibération, mais aussi un contrôle effectif des citoyens européens sur leurs représentants. Ce travail aussi fructueux soit-il se heurtera cependant toujours au vide social inhérent à l’ordre institutionnel de l’UE. Seule une réforme des traités, et une réforme d’une envergure « constitutionnelle » (même si ce terme doit déplaire à certains), serait à même de le combler.
Il est certes beaucoup question actuellement de solidarité européenne. N’y aurait-il pas là un levier social à exploiter au sein même de l’ordre juridique européen ? La difficulté de ce terme, désormais omniprésent en politique européenne, tient tout d’abord à sa polysémie et à la multitude des formes de solidarité qu’il embrasse : interindividuelles ou interétatiques, internes ou externes à l’UE, et de nature politique ou financière. Ses fondations juridiques ne sont guère plus solides, malheureusement. La solidarité figure bien entendu parmi les « valeurs » et « objectifs » de politique intérieure et extérieure de l’UE (art. 2, 3 et 21 TUE). Ces valeurs et objectifs ne sont toutefois pas sources de compétences directes pour l’UE. Il existe en outre bien un « principe » de solidarité dans les traités de l’UE. On le rencontre notamment dans les chapitres des traités consacrés à la politique migratoire et à la politique économique et financière de l’UE, mais ses contours demeurent controversés si l’on se fie à la jurisprudence récente. Quant à la « clause » de solidarité de l’art. 222 TFUE, elle s’applique « si un État membre est l’objet d’une attaque terroriste ou la victime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ». Elle a d’ailleurs été mise en œuvre en mars dernier et consiste avant tout à permettre aux États membres sévèrement touchés par le coronavirus de bénéficier de l’aide du Fonds de solidarité de l’UE. Même si le terme de « solidarité » est désormais devenu le « mantra » des dirigeants européens, on voit bien dès lors qu’il ne s’agit pas encore là du principe juridique et justiciable de solidarité sociale qu’attendent les Européens.
Une telle solidarité ne peut devenir réalité au niveau européen que si l’UE est dotée de véritables compétences sociales qui lui permettent d’œuvrer ensuite à l’égalité sociale de ses citoyens. De telles compétences sociales ne sont envisageables à leur tour que si l’UE bénéficie de ressources budgétaires propres et de compétences fiscales accrues à même de lui permettre d’asseoir ces ressources et de mener à bien ces politiques sociales. Différentes propositions très intéressantes ont été avancées à cette fin, renouant avec certaines idées issues de la révolution américaine comme la corrélation taxation-représentation, mais aussi celle d’une nouvelle union politique fondée sur une dette commune. Pour attribuer de telles compétences sociales et fiscales à l’UE, toutefois, une réforme des traités de l’UE est inéluctable, et la décision de procéder à une telle réforme revient aux citoyens européens.
Pour cela, encore faudra-t-il que ces mêmes citoyens se souviennent du goût de l’égalité sociale, puis politique sans laquelle il ne peut y avoir ni véritable solidarité ni démocratie européennes. A la différence des crises précédentes, cette crise sanitaire touche tous les Européens dans leur corps. La dimension non seulement économique, mais sociale de cette situation inédite saura-t-elle leur rappeler qu’ils partagent non seulement un marché, mais un destin commun et les amener enfin à faire corps politique à l’échelle européenne ? Les Européens tiennent peut-être là le « moment constitutionnel » qui leur manquait il y a vingt ans à Laeken.
Samantha Besson
Chaire de Droit international des institutions
[i] Je ne parle pas ici des mesures de politique économique et monétaire que les chefs des 27 États membres réunis en Conseil européen ont fini par adopter à l’époque et à nouveau cette fois-ci (p.ex. assouplissement des règles budgétaires et des règles en matière d’aides d’État, utilisation du Fonds de solidarité de l’UE) et sur lesquelles le Conseil européen, la Commission européenne, la Banque centrale européenne ou l’Eurogroupe seront encore appelés à innover ces prochains mois (p.ex. Euro-obligations, réforme du Pacte de stabilité et de croissance).
[ii] L’échec du Traité établissant une constitution pour l’Europe de 2004 n’aura toutefois pas permis de reprendre ces termes « constitutionnels » au sein des traités de l’UE.
[iii] Ces pouvoirs seraient même trop étendus, voire « hyperconstitutionnels » selon Dieter Grimm : ils sont en effet au service de principes et objectifs économiques élevés au même rang que d’autres valeurs et principes fondamentaux par les traités de l’UE.
[iv] Cf. notamment la tribune d’Alain Supiot et de différents universitaires suite à un colloque au Collège de France, parue dans Le Monde et dans différents grands journaux européens le 24 septembre 2018 sous le titre (très parlant en ce moment) « Il est encore possible de réanimer l’Union européenne » : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/24/il-est-encore-possible-de-reanimer-l-union-europeenne_5359147_3232.html.
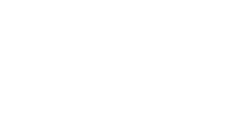
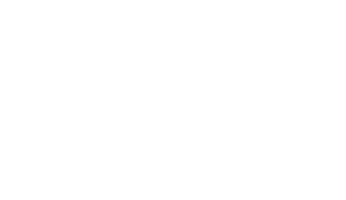




















![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)
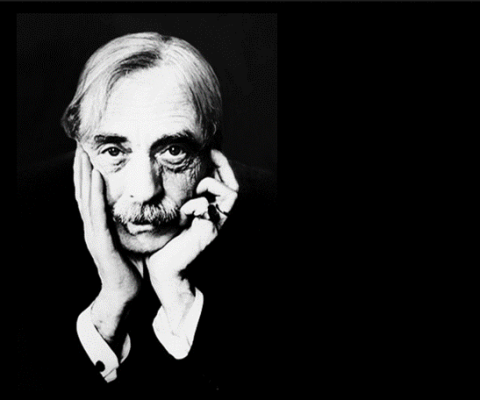


![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)



![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)




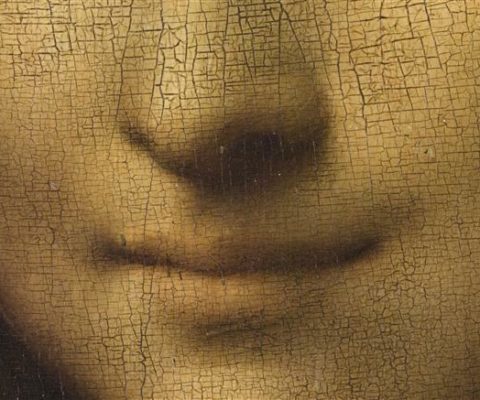

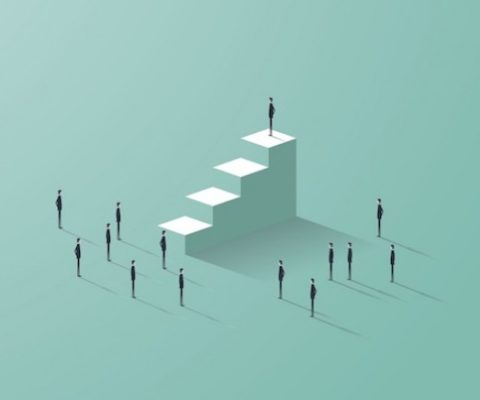
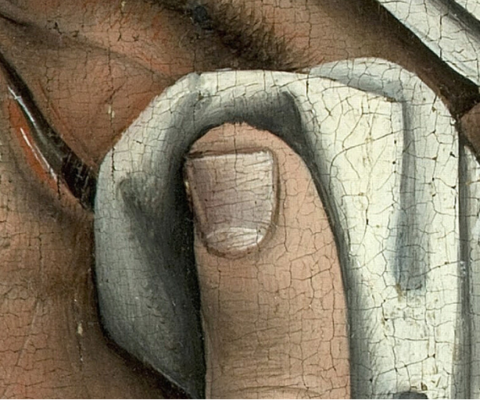

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)



![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)


























![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)